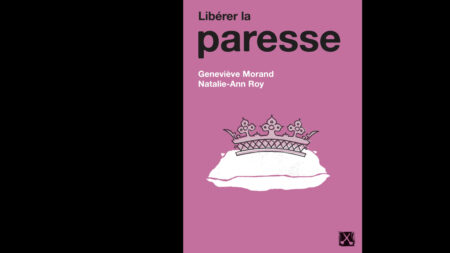Oui, il est quelque peu paradoxal d’aborder l’enjeu central du plus récent livre de l’essayiste Naomi Klein, La maison brûle, alors que le tiers des habitants de la planète sont confinés chez eux des suites de la pandémie de coronavirus, et que la consommation énergétique et la pollution en sont diminuées de façon notable en raison de cette quarantaine forcée. Ceci était dit, l’oeuvre est tout aussi pertinente: après tout, la crise climatique n’est pas disparue, loin de là, quarantaine ou non.
On ne le dira jamais assez: il est urgent d’agir résolument pour contrer les impacts déjà ressentis de la transformation de notre climat des suites de notre activité industrielle, principalement lorsque vient le temps de se transporter d’un point A à un point B. Et s’il est certainement trop tard pour annuler complètement l’impact des transformations à venir, la planète a encore une chance d’éviter le pire.
Bien sûr, il serait plus rapide, probablement, de faire circuler encore plus le coronavirus, histoire que ce soit bien l’ensemble de la planète qui soit forcé de demeurer à la maison pour réduire l’activité économique et ainsi faire retomber les niveaux de pollution. Mais cette solution est catastrophique à plusieurs égards; d’abord, parce qu’elle entraîne, même dans une version « édulcorée » et limitée, c’est-à-dire à l’aune de l’impact du virus sur une partie seulement de la population mondiale, des coûts économiques astronomiques, qui dépassent plusieurs milliers de milliards de dollars, et cela seulement pour maintenir les économies occidentales à flot.
Ensuite, parce que cette crise est à l’image de toutes les autres qui secouent le monde politico-économique, et donc environnemental, depuis des décennies: les riches, aux poches pleines, ont les moyens de vivre en quarantaine pendant des semaines, voire des mois. Après tout, il y a aura bien des subalternes pour continuer de gérer leurs avoirs. Les plus pauvres, cependant, ou même les gens qui appartiennent à la classe moyenne, doivent eux se contenter de miettes, ou, parfois, de plans de sauvetage gouvernementaux, lorsqu’ils ont la chance de vivre dans des pays où le filet social est solide. Aux États-Unis, où le président évoque, sans vraiment clairement le mentionner, que les Américains devraient accepter de risquer de mourir de maladie pour éviter une crise économique, le dilemme est terrifiant.
Il en va de même pour la question environnementale, écrit encore et encore Mme Klein dans ce qui est à la fois une collection d’articles (chroniques? petits essais?) écrits au fil des années, mais aussi un signal d’alerte qui retentit à travers les époques: la planète se meurt à petit feu, et ce n’est pas une pause de quelques semaines qui permettra de s’en sortir. Il y a urgence de transformer notre façon de consommer, d’agir, d’exister. Non pas en s’adonnant à la décroissance folle et en faisant tout en notre pouvoir pour déconstruire l’édifice capitaliste et consumériste, mais plutôt en adaptant celui-ci, dont les fondations ont de toute façon toujours été pourries et chambranlantes, pour en tirer quelque chose de fonctionnel pour tous.
La crise actuelle aura peut-être cela de bon: l’obligation, pour nous, de repenser nos systèmes économiques, politiques, sociaux et environnementaux pour nous assurer non seulement d’être mieux préparés à la prochaine épidémie, mais aussi – et surtout – donner les moyens à tous de passer au travers d’un nouveau choc de cette ampleur.
En attendant, La maison brûle – plaidoyer pour un new deal vert est une nouvelle pierre essentielle apportée à l’édifice de la mobilisation plus que nécessaire. À lire chez Lux Éditeur.