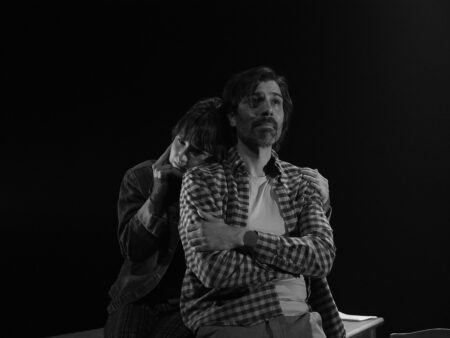Volcan dramaturgique de l’extrême, Angélica Liddell revient bouleverser les plus sensibles âmes par une performance brute intitulée Liebestod. Un exercice fidèle à l’art d’Artaud et sa cruauté jusqu’à l’autoblessure. Dès les premières minutes, la performeuse avertit l’audience: tabula rasa du bonheur et de la niaiserie moderne pour les deux heures à venir, qu’à cela ne plaise… ou non!
Liddell plonge au fin fond du mal de vivre universel, au prix de son hémoglobine avec comme animal métaphorique le taureau, proie du désir de tuer du torero. La figure de l’immortel Sévillan Juan Belmonte s’empare de ses paroles, de sa chair, de ses plaies vives, s’entremêlant à l’ombre de Tristan et Iseut, selon l’oeuvre romantique de Wagner et sa « mise à mort d’amour. »
Lectrice snipper de la dérision et de la mise à nue de la psyché souffrante, l’artiste espagnole trangresse tout code culturel et crache son venin avec le génie de la sincérité.
L’art de Baudelaire et Rimbaud – qui renaît sous nos yeux à sa saison en enfer – de Fassbinder et Bergman agonise là sous les décombres du 21e siècle, époque du néant créatif, des grèves pour le droit à une retraite confortable par des jeunes de Paname.
Gloire aux figurants du spectacle et à la poussiéreuse administration, déglutit Angélica Liddell, sous la transe de l’écoeurement cathartique.
Liebestod: saut dans les tranchées contemporaines du désespoir et de la foule solitude, où le rêve et l’amour épargnent de la mort brutale du fleuve glacée.