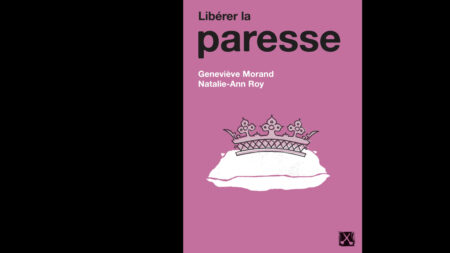Pour ceux qui, comme ce journaliste, sont nés longtemps après la Guerre du Vietnam, ce conflit s’est d’abord fait connaître par les films, en particulier Full Metal Jacket et Apocalypse Now. Mais ce que Putain de mort – Dispatches, en version originale anglaise – révèle, c’est que ces oeuvres de fiction, pourtant jugées comme étant déjantées, extrêmes, voire complètement exagérées, n’ont finalement rien à envier à la réalité.

Putain de mort, c’est le récit, ou plutôt ce qui a des allures de rêve éveillé, du passage de Michael Herr, correspondant du magazine Esquire, directement sur le terrain, là-bas, au Vietnam, à la fin des années 1960. Directement dans l’enfer, devrait-on dire, alors que Herr raconte l’horreur de la guerre dans ce qu’elle a, à la fois, de plus banal et de plus terrifiant. Des morts ici et là, des Marines et des Vietcongs qui se font tuer au petit bonheur la chance, pour un oui ou pour un non… Partout, le désespoir, la tristesse, la faim, la peur. Surtout la peur.
De Saïgon, la capitale, aux tranchées puant la merde et remplies de rats, à quelques centaines de mètres seulement des lignes ennemies, notre homme se promène, jamais complètement combattant, jamais entièrement neutre, non plus. D’abord, parce qu’il est Américain, bien entendu. Mais aussi parce qu’à force de passer du temps avec des gens, on en vient à partager leur quotidien, à comprendre leur point de vue. Going native, dit-on dans la langue de Shakespeare.
Et si notre journaliste devenu chroniqueur, ou plutôt, en quelque sorte, la forme ultime de gonzo, n’ira jamais jusqu’à empoigner une arme et à s’en servir, il est clair qu’il est comme bon nombre de troufions sortis de leurs plaines du Midwest, et envoyés moisir dans la jungle et la boue: il veut être ailleurs. Ce qu’il y a de différent, avec lui, c’est qu’il peut effectivement s’en aller, revenir à un endroit sécurisé, voire rentrer à Saïgon, ou même aux États-Unis.
Pourquoi reste-t-il, alors, à des endroits où il pourrait mourir en une fraction de seconde? Pourquoi va-t-il dormir dans des abris de fortune, avec d’autres soldats qui craignent eux aussi l’ennemi asiatique que l’on dit sauvage et vicieux? Le pire, c’est que la question finit par lui être posée: pourquoi est-il là? Pour la gloire? Il ne défend pas les couleurs de son pays. Pour l’argent? Il n’est pas si bien payé que ça.
Se peut-il que Michael Herr soit simplement accro? Accro à la violence, à la peur, à la mort, à l’adrénaline? Accro à la forme la plus extrême des interactions humaines, ce niveau où il s’agit carrément d’un duel à finir entre deux camps, sans compromis possible?
Ou peut-être voulait-il être là pour tenir un journal de ce moment charnière de l’histoire du 20e siècle? Raconter l’une des facettes du grand chambardement de la société américaine, voire de l’Occident dans son ensemble? Se mettre debout au coeur de ce maelström mêlant décolonisation, guerre d’idéologies, crise des droits civiques, émancipation et fureur militaire?
Quoi qu’il en soit, Putain de mort frappe comme une tonne de briques. En moins de 300 pages, ont est davantage estomaqué et renversé qu’en trois heures de Kubrick et de Martin Sheen. Le tour de force est à la fois monstrueux et admirable. De la très grande littérature. Voire du journalisme littéraire.