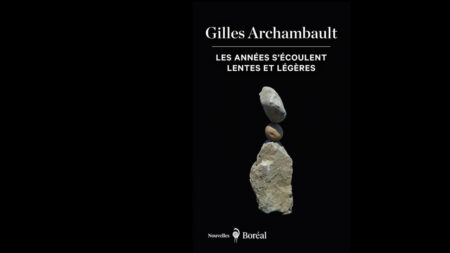Le roman de l’écrivaine Marguerite Andersen, La mauvaise mère, publié chez Prise de parole, explore toutes les facettes enchevêtrées de la relation mère-enfant à travers une question existentielle pour toute mère: « Suis-je une bonne mère? Sinon forcément, je suis une mauvaise mère? »

Avant même de lire les premières lignes du roman, le titre est fort et déclare sans équivoque. C’est un aveu complet et reconnu par la narratrice. Elle se déclare coupable et assume le chef d’accusation d’être une mauvaise mère.
L’écrivaine signe un roman formidable, sur le sujet de la mauvaise mère qui se justifier et qui aurait aimé tant avoir agi différemment. Mais malheureusement, rien ne change le cours de l’histoire. Avec un style dynamique et saccadé, et une forme hybride entre la prose et la poésie, qui confèrent légèreté, et aération du texte, pour partager avec le lecteur des moments intimes. D’ailleurs, chaque chapitre débute par des phrases de grands écrivains tels que Jean-Jacques Rousseau ou George Sand. L’âme de ces écrivains accompagne l’auteure et inspire le lecteur.
Le sujet étant de l’ordre de l’intime, l’écrivaine se sert des premiers chapitres pour justifier l’écriture de soi, l’écriture de ce confessionnel pour débarrasser sa conscience du poids de culpabilité d’avoir abandonné ses enfants en bas âge. La narratrice se laisse parfois exprimer ses sentiments en langue allemande, sa langue maternelle.
Elle remonte l’histoire de sa vie, et guette toutes les occasions, dès les premières semaines de sa grossesse, où elle a tourmenté ce lien sacré mère-enfant. À chaque fois que le sacrifice de la mère n’a pas été complet.
Regrets et reproches appuient une conviction indémontable de sa propre culpabilité. Pour mille et une raisons, elle se reconnaît coupable. À chaque prise de décision dans sa vie, elle est torturée par cette question de liberté individuelle versus le sacrifice maternel : «… ai-je le droit de… ?» D’avorter? De divorcer? De voyager? D’étudier? Et même de faire l’amour? De se remarier? Questionner sa vie de femme dès qu’elle quitte le statut de «Je» pour devenir un «Nous». La crainte de mal faire, ou de faire mal. Une insécurité dans tous ses choix et une anxiété permanente la rongent tout le temps du roman.
Malgré le fait que dans la pratique son audace et sa soif de la vie ont primé sur tout. Elle a eu du plaisir à voyager, à étudier, à déménager sur six pays et trois continents, de Berlin à Montréal. De 1945 à aujourd’hui, elle a traversé le temps plus ou moins seule sans ses enfants. Elle a avancé dans la vie tout en traînant avec elle partout ce boulet dans les pieds et ce poids sur les épaules, ce sentiment d’être une mauvaise mère qui a abandonné ses enfants.
Malgré qu’elle n’ait jamais abandonné ses enfants volontairement. Elle a échappé à un mari qui n’est pas des plus doux et à une belle-mère ferme et rigide, à un pays qui n’est pas le sien. Mais en fond d’elle, la sentence tombe dès le début du roman et ne dérougit pas tout le long. A-t-elle le droit d’être une mauvaise mère pour être une femme qui s’accomplit?
L’auteure a décidé de faire ce retour sur son expérience à l’âge de grand-mère. Elle aurait pu dormir sur ses deux oreilles, et continuer sa vie, en poussant loin d’elle tous les fantômes du passé. En particulier, qu’elle a réussi à avoir une famille heureuse, ses enfants ont réussi dans la vie et l’ont rejoint, elle a également des petits enfants. Mais elle a décidé de faire la paix avec son histoire, probablement dans une tentative de rattraper le temps de maternité perdu.