Un an après avoir créé toute une commotion dans le domaine cinématographique avec son merveilleux Hereditary, Ari Aster revient à nouveau avec l’intention de chambouler notre définition de l’horreur. Ce faisant, il propose un délire encore plus concis et ambitieux qu’à son premier tour de piste. Sans être surprenant, Midsommar impressionne et nous colle à la peau, soyez prévenus.
Ici, le cinéaste ne veut pas nécessairement surprendre, ou encore horrifier, comme on voudrait bien nous le faire croire. Au contraire, Aster est un fin dramaturge qui connaît immensément bien ses codes et a un sens aiguisé de la réflexion pour ce qui est des drames familiaux et des relations intimes en déroute.
Reprenant sa thématique du deuil, il parfait ses qualités d’esthète et s’amuse à nouveau à déconstruire le film d’horreur moderne en l’utilisant plutôt comme excuse afin d’expier de véritables situations horrifiques du quotidien. S’il s’agit encore et toujours de notre époque, tout comme de personnages foncièrement dit « modernes », voilà que Aster s’amuse à les confronter aux traditions et à un classicisme qui n’en a rien à faire de la technologie, en revenant aux sources de tout, désacralisant même le corps humain qu’on tente toujours plus de mieux protéger du « mal » avoisinant dans lequel on a pourtant toujours vécu.
C’est encore plus vrai avec ce Midsommar qui, une fois une introduction sans failles dans la froideur de l’hiver, fuit les inquiétudes de la société actuelle et toute sa noirceur pour s’évader vers la chaleur de l’été suédois et d’une commune isolée.
Sauf qu’à l’instar du splendide Suspiria de Luca Guadagnino, c’est le drame psychologique qui intéresse son cinéaste, d’abord et avant tout, n’y insufflant que l’horreur lorsque celle-ci s’y prête, ou simplement pour se faire plaisir. Puisque voilà, le soin apporté est évident. Méthodique à souhait, le réalisateur a refait équipe avec plusieurs de ses collaborateurs de la veille, comme Pawel Pogorzelski à la direction photo et Lucian Johnston, seul cette fois au montage, repoussant ses propres limites et osant encore davantage. Ces derniers sont par ailleurs rejoints par de nombreux artisans de la région, ce qui apporte certainement un savoir-faire singulier au reste.
Plus près des cauchemars éveillés de Kubrick que de tout ce qui se fait en moyenne dans le genre, Midsommar use d’un rythme poseur et fragile qui met tout en scène, littéralement. Certes, les gestes, les répliques, les déplacements, les réactions, sont plasticisées au possible, mais cela ajoute à l’immense beauté de l’ensemble dont la justesse y est régulièrement chirurgicale, prouvant que rien n’arrive jamais pour rien.
Et comme l’humain et ses réactions demeurent au centre de tout, il lui faut encore une distribution qui ait le talent nécessaire pour interpréter ses délires. Ainsi, au même titre que ce qu’il est parvenu à faire ressortir de l’immense Toni Collette, le voilà qu’il prouve à nouveau l’épatant talent de la nouvelle venue Florence Pugh, qui ne cesse d’en imposer à chacune de ses apparitions et à chaque nouveau projet.
Si Will Pourter persiste à jouer les salopards d’usage et que Vilhelm Blomgren a ce qu’il faut pour tenir tête à ses collèges internationaux plus connus, il fait toujours bon de voir William Jackson Harper continuer d’élargir l’étendue de son jeu lorsqu’il ne fait pas tourner les têtes dans la sitcom essentielle qu’est The Good Place. Pour compléter ces jolis noms, on ne peut passer sous silence l’imposante présence de Jack Reynor, à nouveau excellent dans ce contre-emploi nuancé qui s’amuse considérablement avec ses charmes habituels, mais seulement pour mieux les détourner.

L’amour au centre du récit
Admettons-le tout de suite: si Midsommar est bien des choses et qu’il peut sembler aller dans bien des directions, il ne perd jamais de vue ce qui l’intéresse vraiment, soit son histoire d’amour. Cela peut sembler ridicule ou insensé, mais c’est cette base, particulièrement solide, qui accorde à l’ensemble toute sa profondeur.
Offrant une réflexion particulièrement judicieuse sur les relations dites toxiques qu’on a constamment vu d’hier à aujourd’hui, le long-métrage propose un couple familier, celui qui bien que tout semble pointer en son existence (cela fait-il trois ans qu’ils sont ensemble? Quatre? Impossible!), n’est au fond que le résultat de compromis qui ne devraient pas avoir lieu.
C’est d’ailleurs cette peur de la solitude et de l’éloignement, tout comme cette incapacité à se dire la vérité qui donne lieu aux circonstances du film le poussant toujours plus loin dans ses mensonges et dans ses inévitables revirements. Certes, il ne faut pas chercher midi à quatorze heures dans cette famille de substitution qui se tisse peu à peu, mais il faut y savourer la lucidité dont le cinéaste fait preuve pour constamment enrichir sa réflexion, son univers, ses personnages tout comme leurs motifs.
Moins explicatif que le précédent film, moins académique également, il y a beaucoup plus de liberté ici et encore plus de questions laissées sans réponses et de moments suspendus dans la grâce, entre humour inattendu et malaises implacables, transformant ce trip presque entièrement dans la clarté en une oeuvre qui remet en perspective nos paramètres de sécurité.
Au final, sans trop en dévoiler, Midsommar est à nouveau la preuve du talent remarquable de Ari Aster comme un cinéaste talentueux ayant une vision précise de ses désirs et la capacité incroyable de les matérialiser. Une deuxième proposition encore plus assurée et habile qui promet et permet un périple qu’on n’est certainement pas près d’oublier, quoi qu’il en coûte.
8/10
Midsommar prend l’affiche en salles ce mercredi 3 juillet.


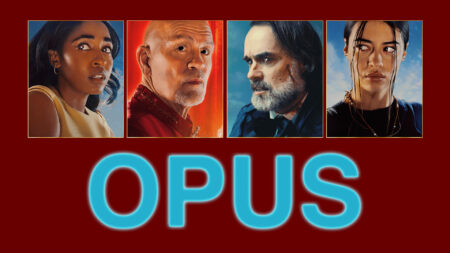



Un commentaire
Pingback: L'audiovisuel québécois au sommet de sa forme - Pieuvre.ca