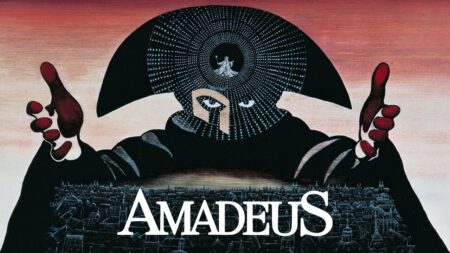« Deux destins qui s’entrecroisent en 1812: un noir et une métisse autochtone / québécoise, qui vont tenter de communiquer et de survivre à ce monde qui les dépasse », lit-on dans un communiqué annonçant le tournage d’un film intitulé The End of Agawa River. Ce projet s’avère être une autoproduction instaurée par trois jeunes artisans du cinéma.
En entrevue, le réalisateur Quentin Fabiani m’explique ce projet qui semble vouloir écrire un nouveau paragraphe de l’histoire canadienne, qui ne manque pas de controverses.
Pourquoi être venu au Québec?
Ma sensibilité cinématographique et le cinéma que j’aime, c’est un cinéma nord-américain. Ça va de tous les détails, les lignes jaunes au sol, les ruelles… J’ai toujours rêvé de faire des films qui se passent dans cette ambiance-là. Je suis venu au Québec quand j’avais 12 ans et j’ai toujours senti que j’allais venir vivre ici.
Comment ce projet de film a-t-il commencé?
À la base c’était censé être la rencontre d’un Anglais joué par Anton qui travaille pour la compagnie du nord-ouest et d’une femme métisse. L’Anglais était un personnage sûr de lui, conquérant, qui n’a pas d’autre vision du monde que la sienne. En fait, on s’est rendu compte en écrivant que ces deux personnages faisaient naître le pire d’eux-mêmes. Cette rencontre donnait des personnages profondément méchants l’un envers l’autre.
Le récit a changé?
Un jour, je marchais avec Anton avec qui j’écrivais tout. Il m’a dit que ce serait intéressant que Patrick, un ami afro-américain, joue le rôle. On a revu le script, puis au lieu de parler de colère on a décidé de parler de ce qui relie les deux personnages. Ce sont deux personnages qui souffrent de leur différence, de leur mixité, de leurs origines. C’est un « black loyalist ». On est parti du principe qu’il est fort probable qu’il y ait eu de l’esclavage à Montréal.
Vous êtes-vous inspiré du cinéma québécois?
Notre inspiration c’est le documentaire L’empreinte (2015) avec l’acteur Roy Dupuis qui parle de ce patrimoine commun entre les premières nations et les premiers Québécois, qui a beaucoup touché Catherine. C’est elle qui a eu l’idée pour le film.
Voulez-vous produire un film historique ou un film intimiste?
En tant que réalisateur, sur Agawa je m’inspire de Sergio Leone qui a fait des westerns spaghettis. C’est un de mes réalisateurs préférés parce qu’il arrive à raconter les histoires par les images plutôt que par les mots. Je voulais que le film commence comme un film d’aventure et qui s’arrête rapidement pour devenir un autre film, un film intimiste. J’ai beaucoup été inspiré d’un film de Tommy Lee Jones que je vois comme un western avant d’être un film historique par la nature, la frontière qu’on repousse tout le temps, le danger et par le fait que tous les éléments que tu ne maîtrises pas peuvent te conduire à la mort.
Pourquoi tourner en pellicule?
Ça oblige toute l’équipe à être dans une rigueur et une efficacité qui n’est pas vraiment là quand tu es en numérique où tu pèses sur le bouton et… c’est gratuit. Pour faire un film de 20 minutes, nous on part avec 1 heure 20 minutes de bobine. Le rapport est de 1 pour 4. On ne peut pas niaiser. Là, tout est archipréparé.
Vous avez fait de la photographie argentique?
Je faisais beaucoup de photo en numérique. Quelqu’un m’a donné un vieil appareil qui date de 1960, j’ai mis 8 ans avant de le sortir de sa boîte. Une amie m’a montré comment ça marchait, puis ça a changé ma vie… le fait de réfléchir, d’attendre avant de prendre une photo. Tu dois manipuler l’appareil par au-dessus et c’est un petit format de photo, qui me revient à 3 ou 4 $.
Que pensez-vous des controverses autour de l’histoire canadienne?
À titre personnel, ma posture n’est pas de parler de l’histoire, mais de la relation entre ces deux personnages-là. Concrètement, ce qu’on a écrit ça peut se passer au Québec en 1812, ça peut se passer sur la Lune en 3700, c’est de tout temps, l’homme va faire en sorte qu’il y ait des castes et des électrons qui se baladent entre les castes. Ça pourrait être une relation entre une intouchable et un hindou, une femme musulmane en Israël, donc le contexte historique est présent, mais ce n’est qu’un contexte qui donne lieu au drame.
Plaire à tous, ce n’est pas un piège?
Un court-métrage, c’est peu de temps. Un instant bref de 20 minutes. On n’a pas le temps d’aborder de fond en comble les sujets qu’on aborde, alors on est obligé de se rapporter à l’intime. Notre volonté n’est pas de donner un coup de pied sous la table et… regardez!
D’où venez-vous?
Je suis du Pas-de-Calais, au nord de la France, une région qui a été très industrialisée avec le charbon. Toutes les mines ont fermé quand je suis né. Aujourd’hui, c’est une région dévastée par le chômage, mais qui a une humanité très forte et une identité qui va au-delà d’être Français. J’aimerais faire un film sur les immigrants italiens qui sont venus travailler dans ces mines parce que c’est mon patrimoine, mon héritage.
Quel est le but de votre court-métrage?
Notre volonté est de montrer une petite étincelle d’humanité dans un monde pourri.